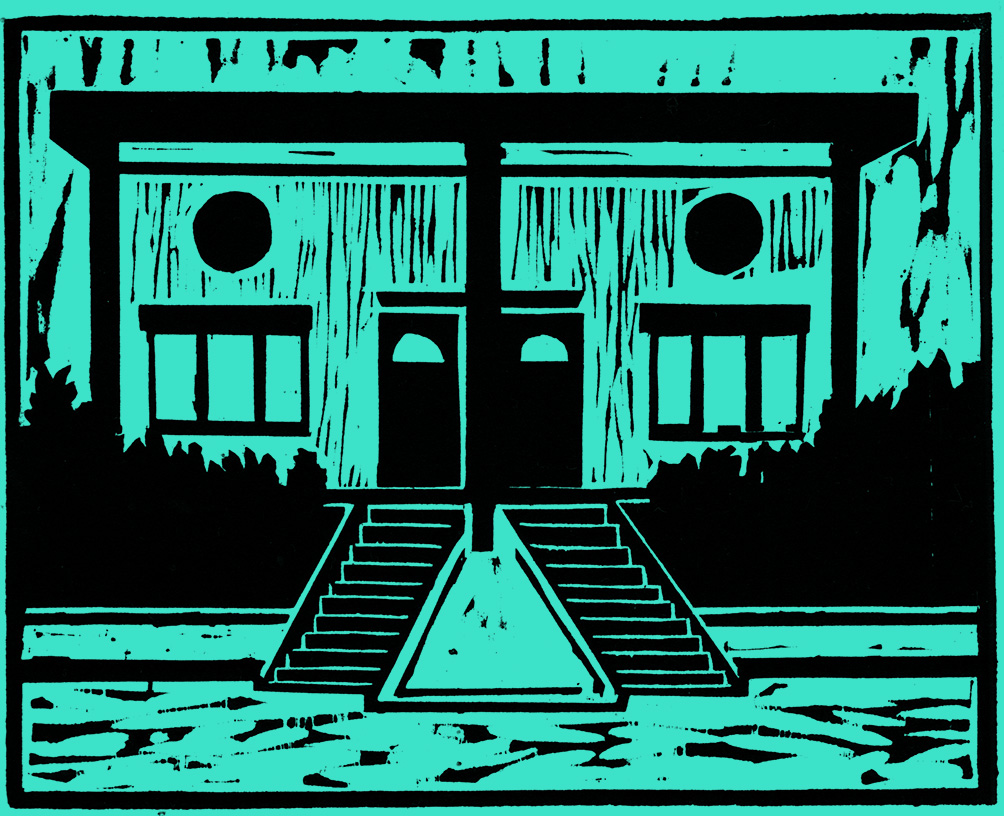
Aux États-Unis, le mouvement de la thérapie familiale naît suite à la Seconde Guerre mondiale pour répondre à des problèmes variés, tels la délinquance ou la schizophrénie. Aujourd’hui, les psychothérapies brèves et comportementalistes qu’il a contribué à élaborer entre 1950 et 1970 foisonnent un peu partout dans le monde occidental. Mais quelles conceptions de la « famille » ont sous-tendu l’émergence de ce mouvement ? Retours sur les débuts, très politiques, de la thérapie familiale, avec le livre de l'historienne Deborah Weinstein, "The Pathological Family. Postwar America and the Rise of Family Therapy" (Cornell University Press, 2013).
***
« Qu’arrive-t-il donc à la famille ? » se demande la célèbre anthropologue étatsunienne Margaret Mead dans le magazine généraliste Harper’s quelques mois avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans les années qui suivent, des articles intitulés « Qu’est-ce qui cloche avec la famille ? »1, « La famille américaine : problème ou solution ? »2 ou « La famille américaine en déroute »3 prolifèrent dans la presse, et Hollywood porte l’adolescence en crise à l’écran – ou plutôt, les familles « en crise » des adolescent·es. La Fureur de vivre, film culte de Nicholas Ray sorti en salle en 1955, s’ouvre sur une scène dans un commissariat de police. Les parents Stark viennent y récupérer leur fils de dix-sept ans, Jim, retrouvé en état d’ivresse sur la voie publique (et interprété par James Dean). Or loin d’être un sermon moral en direction de la jeunesse, comme on aurait pu s’y attendre, le film montre comment les dysfonctionnements internes d’une famille de la classe moyenne (en l’état, un père en manque d’autorité, écrasé par les femmes de la maison) engendrent des « rebelles sans causes » (le titre original du film), des rebelles cherchant « le père » aux mauvais endroits.
Interdit aux moins de dix-huit ans à sa sortie en France l’année suivante, La Fureur de vivre s’adresse, outre aux « amateurs de bons films », à « vous, parents », selon l’un des critiques cinéma du journal Le Monde4. À la même époque, le psychiatre étatsunien Nathan Ackerman, également cheville ouvrière de la « thérapie familiale », considère en effet que « le comportement perturbé de l’adolescent ne doit pas seulement être compris comme l’expression d’une étape particulière de son développement, mais comme le symptôme d’un désordre parallèle dans la structure de la famille, de la société et de la culture ». Après avoir précisé que la délinquance juvénile augmentait partout dans le monde, ce même médecin complète : « La famille, en tant que système de comportement, se trouve à la jonction entre l’individu et la culture. C’est elle qui transmet, via ses membres adolescents, le désordre qui caractérise ensuite le système social. […] La mauvaise conduite de l’adolescent doit être vue comme le symptôme d’une pathologie chronique dont souffre la famille entière. »5 Aussi, pour résoudre le problème de l’adolescence troublée et résorber le « désordre social », faut-il soigner ces familles qui « clochent » – dont parlent alors tant les journaux.
La famille, garante de la démocratie
Aux États-Unis comme ailleurs, la sphère familiale connaît de profonds changements pendant, puis après la Seconde Guerre mondiale. Les hommes (et les pères) se trouvent massivement et durablement éloignés de leurs foyers par la guerre, tandis que de plus en plus de femmes mariées (et de mères) rejoignent les rangs des salariées (une tendance amorcée pendant la Grande Dépression). Puis arrivent les « Trente Glorieuses », dont la première décennie se traduit par une vive augmentation des mariages et des naissances (mais aussi des divorces) ainsi que par une politique d’accession à la propriété en direction des classes moyennes blanches, soit un intense mouvement de suburbanisation (les fameux pavillons). Le modèle capitaliste de la société de consommation se diffuse rapidement en ciblant de nouveaux « marchés » (principalement les enfants, les jeunes et les femmes au foyer) et l’arrivée de la télévision dans les foyers permet à de puissants idéaux domestiques de se répandre, comme « une douce alternative aux tensions de l’après-guerre »6.
Par ailleurs, précise Deborah Weinstein, « [la guerre] a aussi accentué l’importance idéologique de la famille en soulignant les liens entre l’éducation des enfants et la production des citoyens démocratiques ». La période constitue en effet la caisse de résonance de plusieurs théories liant la fabrique de la famille à celle de la démocratie, à commencer par « le discours sur la famille démocratique ». Élaboré dans les années 1930 et promu par la classe politique et les agences gouvernementales pendant le conflit, ce discours ambigu part du constat que la structure de la famille est, depuis le début du XXe siècle, de moins en moins patriarcale, et encourage de ce fait les femmes à conserver leur rôle traditionnel de mères au sein du foyer afin d’alimenter le caractère « démocratique » de la cellule familiale – autrement dit, à ne surtout pas rejoindre la force de travail salariée et à produire de bons citoyens7. « La démocratie, comme la charité, commence à la maison », soulignait peu avant la guerre l’influent chercheur en sciences sociales Lawrence K. Frank8, qui défend quant à lui l’existence d’un rapport de causalité (vertueux) entre l’équilibre psychologique des citoyens, l’importance des pères dans l’éducation, le rejet du fascisme et la santé de la démocratie – une corrélation qui n’est pas sans évoquer les hypothèses sous-tendant l’élaboration du California F-scale, un test de personnalité conçu en 1947 par le philosophe allemand Theodor W. Adorno et d’autres confrères ayant fui le nazisme, dans le but de déceler les personnalités présentant un attrait pour l’autoritarisme.
Parallèlement, se diffuse la théorie du « momism », introduite par le livre à succès de Philip Wylie, Generation of Vipers, en 1942. Habituellement auteur de romans de science-fiction, Wylie se livre ici à la critique d’une série de figures qui seraient à l’origine de la « crise de la société étatsunienne », au rang desquelles les mères trop protectrices (mais dans le fond manipulatrices et autocentrées). En entravant les capacités d’adaptation de leurs enfants au monde extérieur, celles-ci menaceraient, in fine, l’équilibre de la nation. Cette théorie s’inscrit dans l’histoire, plus longue, des accusations portées aux mères, et aux mères seulement, quant à leur responsabilité dans le « mauvais » développement de leurs enfants9, et elle rencontre alors un succès inédit qui s’explique notamment par les enjeux politiques de la période.
En effet, alors que les sociologues Talcott Parson et Robert Bales publient Family, Socialization and Interaction Process, où ils soutiennent que les « personnalités ne naissent pas dans mais sont créées par les familles », le compte rendu de la White House Conference on Children and Youth10 de 1950 insiste sur le fait que les « personnalités équilibrées, matures et émotionnellement stables » sont à la fois « un objectif et une garantie de la démocratie ». Le contexte est à la guerre froide, sur fond de terreur anticommuniste et d’escalade nucléaire, et c’est la première fois que cette conférence, organisée tous les dix ans depuis 1909, délaisse le sujet de l’enfance défavorisée et de la lutte contre les inégalités pour se centrer spécifiquement sur les besoins psychologiques des enfants et des jeunes, et les « problèmes sociétaux » que posent ces dernier·es (en particulier la délinquance juvénile et les grossesses adolescentes). Ainsi que l’a montré l'historienne Elaine Tyler May, la stratégie de l’« endiguement » comme politique étrangère étatsunienne dépasse très rapidement le champ des relations internationales pour s’appliquer à la vie quotidienne et domestique nationale, où les « menaces » à l’ordre social doivent être neutralisées11.
Aussi, dans ce vaste mouvement où la famille, en proie à de profondes transformations au sortir de la guerre, est paradoxalement identifiée par les experts en tout genre et les médias comme la garante de la stabilité de la démocratie, les parents (et plus particulièrement les mères) sont-ils considérés responsables d’une kyrielle de « problèmes » allant de l’homosexualité à la discrimination raciale en passant par la délinquance ou la schizophrénie… Comme l’écrira plus tard l’historien James Gilbert, cité par Déborah Weinstein : « Entre 1940 et 1960, les Américains portaient à la fois un regard optimiste et désespéré sur la famille. »
La famille, lieu de la thérapie
Pendant la guerre, la décompensation psychique de soldats qui ne présentent aucun antécédent psychiatrique attire l’attention des médecins : pourquoi, sous l’effet du stress ou suite à un traumatisme, certains craquent et d’autres non ? La responsabilité des mères est à nouveau invoquée, de même que le lien, clairement formulé par la psychanalyse, entre le moment de l’enfance et la constitution des psychés. Ces observations encouragent les pouvoirs publics à développer le champ de la prévention en direction des personnes a priori « normales », ce qui revitalise, dans l’immédiat après-guerre, le courant de « l’hygiène mentale » (ensuite renommé « santé mentale »).
Forgé au tout début du XXe siècle par Clifford Beers, un ancien patient, et par le psychiatre suisse émigré Adolf Meyer, ce courant encourage la psychiatrie à sortir de l’hôpital en prévention de problèmes sociaux comme la criminalité, l’alcoolisme ou la prostitution. L’hygiène mentale prend pour objet la capacité d’ajustement d’un individu à son environnement social, capacité qui s’acquerrait au moment de l’enfance grâce à l'intervention des parents. Autrement dit, ce sont les parents qui, en élevant leur enfant, sont responsables de son équilibre psychologique, quelles que soient l’appartenance sociale ou la constitution biologique de ce dernier. Plus généralement, le concept véhicule l’idée qu’une intervention thérapeutique sur les méthodes éducatives favorise les conditions du bien-être psychique de l’enfant. C’est ainsi que dans le contexte étatsunien de l’après-guerre, où l’accent est à la fois mis sur la prévention psychologique et la promotion de la démocratie, l’État finance la création d’un Institut national de la santé mentale en 1949 et des recherches envisageant des problèmes sociaux tels que la pauvreté ou la délinquance comme le produit de blessures psychologiques souvent ancrées dans l’enfance.
Si la famille est désormais le lieu où s’élaborent les personnalités et la démocratie, s’il faut traiter y compris les personnes qui vont apparemment bien, et s’il est possible d’enrayer toute une série de problèmes sociaux en agissant sur le contexte éducatif, qui faut-il soigner quand ça va mal ? Une personne en particulier (délinquant·e, schizophrène ou homosexuel·le) ? Ou sa famille, qui favorise l’apparition et le maintien du symptôme et du désordre social ? Le mouvement de la thérapie familiale, qui commence à se constituer comme champ clinique au début des années 1950, entend répondre de manière pragmatique à ces interrogations. Comme le montre Deborah Weinstein, ce mouvement s’inscrit dans la filiation du conseil conjugal, très développé pendant l’entre-deux-guerres en Europe comme aux États-Unis, mais s’en distingue par ses objets et méthodes. Il ne s’agit plus de conseiller au sujet de problèmes aussi divers que la relation conjugale, l’éducation, la gynécologie ou la sexualité, mais bien de soigner la famille, conçue comme une unité thérapeutique. La nuance est de taille : la famille n’est pas envisagée comme la cause d’un problème mais comme un organisme disposant d’un « moi », dont les membres exprimeraient la pathologie ; aussi l’attention thérapeutique est-elle portée sur les interactions entre les différents membres de la famille, censées mettre à jour et entretenir les dysfonctionnements, plutôt que sur les psychés individuelles (exit l’inconscient).
Murray Bowen, l’un des pionniers de la thérapie familiale avec les psychiatres Nathan Ackerman, Salvador Minuchin et l’anthropologue Gregory Bateson, évoque la formation de ce champ clinique comme le fait d’une « bande de frangins » pour insister sur la multitude des personnalités (masculines) et des méthodes constitutives de ce mouvement. Mais aussi variées les approches de cette thérapie sont-elles en cette moitié de siècle, toutes partagent le principe selon lequel la pathologie de la famille ne peut s’appréhender qu’au moyen d’une observation des interactions « in vivo », grâce à la consultation de groupe, aux miroirs sans tain ou à la caméra qui filme des tranches de vie (analysées ensuite par les psychiatres et autres thérapeutes). Et presque toutes envisagent la famille comme un système clos ou pour le moins détaché du monde social, un aspect qui détermine évidemment le sens et les techniques du soin. À cet égard, Deborah Weinstein revient minutieusement sur l’école de Palo Alto qui, à l’initiative de Bateson, regroupe des chercheurs et des praticiens cherchant à appliquer le modèle de la cybernétique à la famille et à l’étude de la schizophrénie principalement. Comparant la famille à un système d’interactions homéostasiques (soit un organisme s'autorégulant mécaniquement autour d'une norme, quel que soit le contexte), ces derniers entendent démontrer que les « familles pathologiques » participent à la création et l’entretien des symptômes. Ainsi posé, un·e patient·e schizophrène (ou délinquant·e ou homosexuel·le) incarne la structure pathologique de sa famille, laquelle a néanmoins besoin de ce symptôme pour assurer sa cohérence et son maintien (autrement dit, c'est le ou la patient·e qui, grâce à son symptôme, assure la stabilité de la famille pathologique). Le soin, lors de thérapies brèves, passe par des exercices et des injonctions cherchant à reprogrammer le système familial autour d’une nouvelle norme, saine cette fois-ci. Mais laquelle ?
La famille, mais quelle famille ?
Alors qu’il revient sur sa manière d’amorcer la première séance d’une thérapie familiale, le célèbre psychiatre Don Jackson, membre de l’école de Palo Alto, explique à la fin des années 1960 : « Je m’adresse presque toujours au père pour commencer. Le mythe implique que ce soit le père qui ait la charge de la famille, or il est souvent moins au courant de ce qui se passe, et se sent particulièrement insécurisé car il est dépassé par la situation et souvent dominé par sa femme. » De son côté, Nathan Ackerman revient en 1966, dans son livre Treating the Troubled Family, sur la partition « universellement » genrée de la famille : « Le corps de la mère est fait pour porter l’enfant et lui donner naissance… Le corps du père est structuré autour de la force et de la puissance. Il est le protecteur de la mère et de l’enfant. » La même année, Fred Ford et Virginia Satir, du Mental Research Institute (MRI)12, proposent cette définition de la famille lors d’une formation intensive à la thérapie familiale : « Une famille = trois personnes ou plus, 1- le mari 1- la femme 1- l’enfant. Une famille incomplète = mari ou femme sans enfant. Une famille = un système avec une série de sous-systèmes. […] Une famille = un système = des règles. » Il va sans dire : au moins pendant ses vingt premières années, les pionnier·es de la thérapie familiale promeuvent une vision hétéronormée et nucléarisée de la famille, fondée sur un partage des rôles de genre on ne peut plus univoque et une mise en accusation régulière des fonctions pathogènes des épouses et des mères. Mais qu’attendre d’une pratique socialement située (élaborée dans les années 1950 par ou pour la classe moyenne blanche étatsunienne, ou du moins pour en diffuser les valeurs13), qui émerge aux États-Unis en pathologisant des problèmes notamment sociaux et emprunte aux mathématiques pour réguler des processus humains à l’instar d’un système mécanique ?
À la fin des années 1970 puis lors des deux décennies suivantes, une critique féministe émerge au sein même de ce courant, les praticiennes dénonçant les inégalités de genre qui structurent la pratique de la thérapie familiale (dont le partage hommes-médecins/femmes-travailleuses sociales), le modèle normatif de la famille encore à l’œuvre dans de nombreuses écoles de formation, ainsi que l’approche de la « causalité circulaire » dans le système familial, qui déresponsabilise systématiquement les hommes de la violence qu’ils exercent sur les membres de sa famille14. Dans les années 1990, l’ouvrage de Monica McGoldrick, Re-Visioning Family Therapy: Race, Culture and Gender in Clinical Practice, propose quant à lui une approche intersectionnelle de la thérapie familiale : « Ce livre est né de la nécessité croissante, pour les praticien·nes de la thérapie familiale, de nous affranchir des contraintes de la représentation parcellaire de la famille comme blanche, hétérosexuelle, de la classe moyenne, et de redéfinir les frontières de notre champ »15.
Et de la nécessité, espérons-le, de s'affranchir de la mission de sauver le pays de tous les périls possibles en libérant la famille de son rôle pivot entre « ordre social » et « désordre individuel ». Mais ceci, le livre de Deborah Weinstein, qui se concentre sur les années 1950 et 1960, ne le dit pas.
Ce qu'on sait pertinemment, en revanche, c'est que les thérapies brèves et/ou systémiques et/ou comportementales définies au sein du MRI ou dans son sillon ont ensuite déferlé en Europe dans le monde de l’hôpital, de l'entreprise et des cabinets privés sous de multiples formes, courants, développements. À vouloir sauver l'Amérique, c'est un empire qui a été construit. ⚕