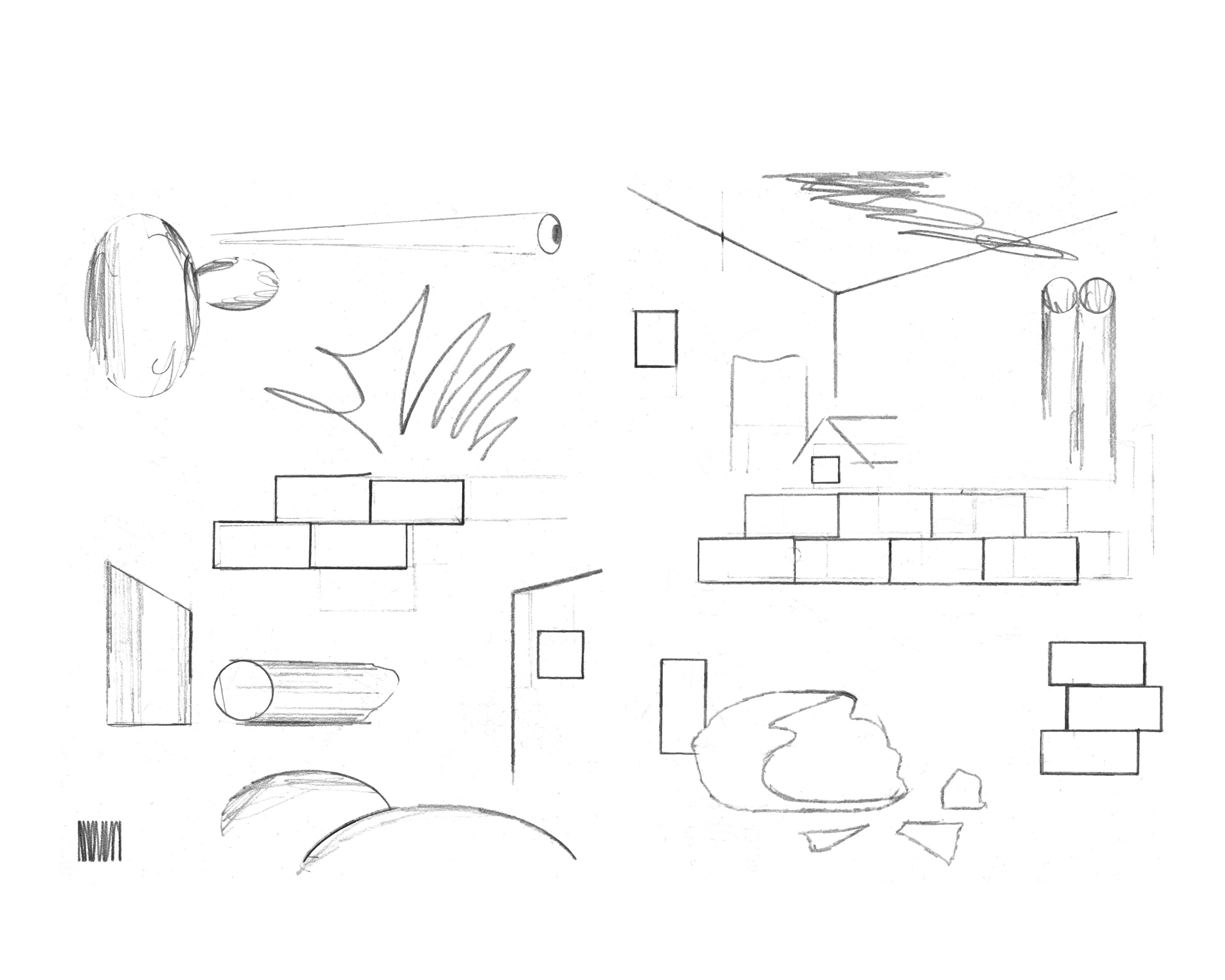
Dossier : Flagrants dénis
Thèmes : État, inégalités, institution, travail, travail gratuit
Illustration : Roméo Julien
J’ai passé le mois à bosser dans une structure d’insertion mais n’ai touché aucun salaire, ni obtenu de droit à la retraite, et je dois prouver à mon conseiller en placement que j’ai consacré mon temps libre à chercher un vrai travail. Qui suis-je ? Je suis une chômeuse suisse assignée à une « mesure active ».
Depuis plus de vingt ans, les pouvoirs publics suisses redoublent d’efforts pour lutter contre les « trappes à inactivité » que seraient l’assurance chômage, l’assurance invalidité ou l’aide sociale. Pour cela, ils ont déployé des mesures de formation et d’insertion dites « actives », censées favoriser le retour sans tarder des personnes sans emploi sur le marché du travail.
Or ces mesures ont surtout contribué à l’émergence d’un monde du travail parallèle, où les activités exercées ne sont pas reconnues comme du « vrai » travail. Alors que la logique de l’activation connaît un succès croissant, notamment en Europe, il semble judicieux d’aller voir ce qui se passe quand elle est étendue à plusieurs domaines de la protection sociale.
La sociologue Morgane Kuehni s’est intéressée à ce système, au rôle qu’y joue l’État et au vécu de celles et ceux qui en font l’expérience. Entretien.
•
Qu’est-ce que la mise en place des « politiques d’activation » a changé dans la protection sociale suisse ?
Le déploiement de ces politiques s’est adossé à une révision de la loi sur l’assurance chômage au milieu des années 1990, justifiée par l’augmentation spectaculaire du taux de chômage au début de la décennie. Le gouvernement a alors mis en place des Offices régionaux de placement proposant un suivi personnalisé des chômeur·ses et a progressivement instauré des mesures dites « actives », comme des cours de rédaction de CV, des programmes d’emploi temporaire ou encore des entreprises fictives à vocation d’entraînement. Telles qu’utilisées aujourd’hui, les mesures actives visent à développer l’employabilité des individus et sont une contrepartie exigible en échange du versement des indemnités. Les politiques d’activation permettent de faire pression sur les bénéficiaires, qui ne sont pas seulement obligé·es d’accepter tout emploi jugé « convenable », mais peuvent aussi être « assigné·es », selon la terminologie officielle, à suivre les mesures proposées, sous peine de voir leurs indemnités suspendues pour un temps déterminé.
Des politiques semblables ont rapidement suivi dans d’autres domaines de la protection sociale, comme l’aide sociale ou l’assurance invalidité, dont les révisions successives visent à réduire le nombre de rentes1 au profit d’un retour au travail. Les dispositifs varient selon les régimes considérés, mais aussi selon les cantons, car l’État suisse est très décentralisé. En plus du suivi individualisé, on peut trouver des formations, comme des cours de français, d’informatique ou de gestion de projets, des mesures dites spécifiques, comme les allocations d’initiation au travail qui financent une partie du salaire pendant un certain temps, et enfin des mesures d’emploi ou d’insertion professionnelle, dans lesquelles les personnes travaillent, le plus souvent entre trois et six mois. Quant aux personnes ciblées, il est difficile d’en définir un profil type, tant les dispositifs sont divers et leurs objectifs disparates. Une même mesure peut viser l’acquisition de compétences pour une personne et l’évaluation de la disponibilité pour une autre, par exemple vérifier qu’elle ne travaille pas au noir ou qu’elle a bien une solution de garde pour ses enfants. Mais les analyses statistiques montrent que les hommes et les personnes sans diplôme ou dont les qualifications ne sont pas reconnues sont davantage concerné·es par les mesures d’emploi.
En quoi ces politiques diffèrent-elles de tentatives plus anciennes de mise au travail ?
Il est vrai qu’elles réactivent un vieux débat sur le travail. D’un côté, le travail est le « support » de l’indépendance économique et sociale, pour parler comme Robert Castel2. En cela, il a une dimension intégrative. D’un autre côté, contrairement aux indemnisations ou aux minima sociaux, le secours ou l’aide apportée sous forme de travail a aussi une dimension coercitive, et peut servir à limiter les abus, les fraudes. Au-delà de cette ambivalence persistante entre intégration et coercition, il me semble que la spécificité des politiques d’activation tient à trois éléments.
Le premier concerne la place que ces politiques réservent à l’individu. Elles marquent le retour de la faute individuelle et du contrôle social exercé envers les personnes sans emploi, mais elles s’appuient aussi sur les capacités d’agir des personnes, qui devraient être « actrices » de leur réinsertion. L’activation les responsabilise face à ce que la sociologie appelle les « risques sociaux », c’est-à-dire les événements potentiellement coûteux de la vie : maladie, perte d’emploi, vieillesse, invalidité…
Le deuxième élément réside dans une redéfinition de ce qui est considéré comme de l’« inactivité légitime ». En s’appuyant sur une vision du travail comme un impératif moral pour accéder à la citoyenneté sociale, les politiques d’activation étendent l’injonction à l’activité : il faut mettre au travail les personnes dépendantes des prestations sociales, mais aussi les mères au foyer, les personnes en situation de handicap ou même les retraité·es. Le dernier élément concerne les liens entre ces politiques et les transformations du salariat.
Comme dans les autres pays européens, le marché du travail suisse est marqué par une flexibilisation et une précarisation croissantes, à laquelle l’activation contribue, car la menace de devoir travailler dans le cadre d’une mesure active pousse en quelque sorte les individus à sortir des dispositifs d’assurance et accepter des emplois moins bien rémunérés, parfois en dehors de leur domaine de compétences ou précaires, mais qui leur assurent tout de même un salaire. À travers ces politiques, les pouvoirs publics ont instauré une nouvelle figure, celle du « travailleur précaire assisté »3.
« Les mesures actives sont
une contrepartie exigible en échange
du versement des indemnités. »
Les « mesures actives » se déroulent donc en dehors du marché du travail « classique » ?
Dans le domaine des assurances sociales ou de l’aide sociale, les mesures actives se déroulent quelquefois sur le marché du travail classique, dit « primaire », auprès d’entreprises privées ou d’administrations publiques. Mais le plus souvent, elles sont organisées avec des prestataires spécialisés dans l’insertion professionnelle, donc sur le marché du travail qu’on appelle « secondaire », qui n’obéit pas à la logique de l’offre et de la demande de travail et répond à des objectifs de politiques sociales. Qu’elles se déroulent sur le marché primaire ou sur le marché secondaire, les mesures actives ne donnent pas droit à un salaire, et dérogent en ce sens aux réglementations en vigueur sur le marché du travail.
Par ailleurs, c’est l’État qui demande à des prestataires de créer des places de travail réservées et de mettre les chômeur·ses ou les personnes à l’aide sociale au travail. L’État détermine quelles institutions peuvent offrir des places et à quelles conditions, de même qu’il détermine qui peut occuper ces places et à quelles conditions. C’est l’échange entre l’État et les prestataires autour de la création des places qui transforme ces personnes en main-d’œuvre. C’est ce que nous appelons le « marché complémentaire »4, en reprenant une notion habituellement utilisée de façon légèrement différente en Suisse.
Les places de travail y sont réservées à des personnes avec un statut administratif spécifique : les chômeur·ses, les rentier·es de l’assurance invalidité ou les bénéficiaires de mesures de l’assurance invalidité, les bénéficiaires de l’aide sociale ; mais cela peut concerner aussi des civilistes5, des condamné·es exécutant leur peine sous forme de travail d’intérêt général, des détenteur·ices d’un permis de requérant·es d’asile ou d’un permis de séjour provisoire, qui sont mises au travail par d’autres voies que celle de l’activation. L’activation n’est donc pas le seul moteur de ce marché, mais elle a largement contribué à son installation durable et à son extension.
Comment se déroulent les differents échanges sur ce marché de places de travail ?
Comme je l’ai dit, pour créer des places de travail destinées à des personnes à statuts administratifs spécifiques, l’État peut s’adresser soit à des entreprises privées et à l’administration publique, soit à des institutions spécialisées dans l’insertion professionnelle. Dans le premier cas, le moins fréquent, les places sont généralement fournies gratuitement. Une banque ou une bibliothèque universitaire, par exemple, accueilleront une personne bénéficiant de l’assurance invalidité dans le cadre d’une mesure de placement à l’essai. Ces prestataires peuvent voir dans cet échange un service rendu à la communauté, mais aussi un intérêt économique : « tester » une main-d’œuvre sans procédure de recrutement et sans la rémunérer — ici la personne bénéficie d’indemnités journalières payées par l’assurance invalidité.
« L’activité ne fournit donc ni objectivement,
ni symboliquement le statut de travailleuse
à la personne qui l’exécute. »
Les institutions spécialisées, quant à elles, vivent de cet échange et fournissent un grand nombre de places de travail. Celles-ci sont payantes pour l’État ; leur prix comprend les frais de fonctionnement, du local, le salaire du personnel encadrant et le matériel, il varie selon le mode de financement, le statut administratif de la main-d’œuvre ou le type de mesure. Caritas ou l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière, par exemple, proposent des places de travail dans des secteurs d’activité très diversifiés : menuiserie, restauration, vente, etc. Il arrive aussi que des entreprises privées « louent » à bas coûts, chez ces prestataires spécialisés, de la main-d’œuvre pour des tâches jugées non rentables, comme le recyclage dans une entreprise d’armement…
Les situations de mise au travail varient selon les régimes administratifs considérés. Dans le cas des rentiers et rentières de l’assurance invalidité par exemple, l’État fixe le cadre de l’échange en ouvrant des places au sein d’ateliers protégés6, sans contraindre les personnes à y travailler. Il ne fournit donc pas stricto sensu la main-d’œuvre. Pour les mesures actives de l’assurance chômage ou de l’aide sociale, la mise au travail relève de l’assignation : les personnes sont obligées de travailler et n’ont pas le choix du prestataire. Alors que dans le cas du service civil, par exemple, l’État détermine l’obligation de travailler, mais le choix du prestataire est laissé à l’initiative des civilistes.
Des personnes aux statuts extrêmement variés se retrouvent donc à bosser dans les mêmes institutions, les mêmes entreprises. Mais toutes ne sont pas reconnues comme travailleuses…
Dans une cuisine de crèche ou un établissement médico-social peuvent en effet se côtoyer des civilistes, des personnes assignées à des mesures actives dans le cadre de l’assurance chômage, de l’assurance invalidité ou de l’aide sociale, mais aussi des salarié·es « classiques ». Ces personnes peuvent exécuter les mêmes tâches mais n’ont pas les mêmes conditions de travail et ne touchent pas la même rémunération à la fin du mois. Certaines ont des salaires, d’autres des allocations perte de gain7, d’autres des indemnités journalières, d’autres encore des forfaits d’aide sociale avec un supplément. Les personnes concernées par des mesures actives produisent des biens et des services mais restent formellement dépendantes du système de protection sociale, ne touchent aucun salaire et leurs jours travaillés ne sont pas comptabilisés pour ouvrir un nouveau droit à l’assurance chômage. L’activité ne fournit donc ni objectivement, ni symboliquement le statut de travailleuse à la personne qui l’exécute.
Ce déni de travail, comme le dirait Maud Simonet8, ne dépend ni des activités effectuées, puisque les mêmes peuvent être salariées par ailleurs, ni des compétences des personnes ou de leur investissement dans la tâche. Ce déni tient plutôt aux stigmates qui collent au statut des personnes exclues de l’emploi, qui sont vues avant tout comme chômeuses, invalides ou assistées : elles ne seraient pas assez compétentes, pas assez motivées, pas assez productives, trop abîmées, etc. C’est particulièrement difficile à vivre pour celles qui ont forgé leur identité dans le travail salarié, car l’assignation à une mesure active redouble en quelque sorte la disqualification professionnelle : « Si je suis ici, c’est bien parce qu’il me manque quelque chose… » Une personne au chômage qui travaille temporairement au sein d’une institution spécialisée dans la réinsertion qui fait de l’électronique ou de la cuisine, reste travailleuse sans emploi9. Et même si elle travaille quotidiennement, elle est soumise aux mêmes devoirs et obligations que les personnes au chômage. Elle se retrouve donc dans une situation de double subordination : elle est subordonnée à celles et ceux qui l’encadrent et supervisent le bon déroulement du dispositif, fixent les horaires, définissent les tâches et évaluent sa prestation de travail, mais elle est aussi subordonnée à son conseiller ou sa conseillère en placement, qui juge les efforts fournis pour retrouver rapidement un emploi et détermine le droit aux indemnités chômage ou au revenu d’assistance.
« Tenir pour résister à l’imposition
d’une image dévalorisée de soi-même. »
Les mesures actives rencontrent-elles des résistances ?
Bien sûr. L’aspect « menace » et « sanction » des mesures actives a été documenté dès leur mise en œuvre. L’assignation s’avère efficace pour diminuer le taux de chômage car certaines personnes préfèrent quitter l’assurance chômage plutôt que d’être assignées à une mesure active. Le renoncement aux indemnités n’est toutefois possible qu’à la condition d’avoir une autre source de revenu — un emploi, un·e conjoint·e… Au-delà de l’évidence de la contrainte, il existe beaucoup de motifs pour tenir le poste, comme je l’ai constaté lors d’une enquête sur les emplois temporaires subventionnés dans le cadre de l’assurance chômage10. Les raisons sont multiples et varient selon les personnes, leur parcours, leur attachement à l’emploi. L’espoir de décrocher un emploi à travers les réseaux, celui de sortir de la solitude ou encore de retrouver un rythme « normal », sont autant de justifications entremêlées qui expliquent que les personnes tiennent en situation d’assignation. Elles ne jouent pas simplement leurs intérêts (se faire un réseau, boucher les trous de leur CV, etc.), elles jouent également « leur peau », leur identité.
Aux raisons pratiques, on peut ajouter les raisons morales ou symboliques qu’il y a à tenir, comme résister à l’imposition d’une image dévalorisée de soi-même : celle d’une personne qui abuse, d’une fainéante ou de quelqu’un·e qui ne sait pas ou ne veut pas travailler. Et puis dans certains cas, des collectifs de travail prennent forme et subvertissent les règles du jeu souvent très rigides qui sont imposées dans le travail assigné. Dans un magasin de seconde main par exemple, des femmes donnaient des jouets aux enfants de clientes en l’absence de la responsable.
Les personnes que j’ai rencontrées dans mes recherches ne sont pas dupes, elles font très clairement la différence entre un « vrai » et un « faux » travail. Ce qu’elles expérimentent au quotidien, c’est la réalité des rapports de domination : l’exploitation bien sûr, mais aussi l’expropriation car à la différence du salariat elles ne jouissent pas de la liberté contractuelle.